Pesticides
Dès le printemps, un même scénario se répète : jardiniers amateurs et employés des services d'espaces verts, pulvérisateurs sur le dos, se lancent dans une bataille pour débarrasser graviers, terrasses et allées de jardin des plantes et insectes indésirables. Dans les champs, les agriculteurs pulvérisent sur de vastes espaces des produits phytopharmaceutiques pour protéger les cultures contre une myriade d’envahisseurs.
Cependant, ces pratiques ne sont pas sans risques pour notre santé et l'environnement. Les découvertes récentes sur la toxicité des produits phytopharmaceutiques appellent à une plus grande prudence vis-à-vis de ces produits. Certains publics, plus fragiles, doivent être tout particulièrement protégés. Sans oublier qu'il y a lieu d'examiner si le contenu de nos assiettes ne contient pas de résidus de pesticides préoccupants pour notre santé.
Des armes à double tranchant
 Depuis des siècles, l’homme protège ses cultures des visiteurs indésirables tels que les insectes et champignons. Éviter leurs dommages est un réflexe naturel, à condition de ne pas se nuire soi-même avec les pesticides.
Depuis des siècles, l’homme protège ses cultures des visiteurs indésirables tels que les insectes et champignons. Éviter leurs dommages est un réflexe naturel, à condition de ne pas se nuire soi-même avec les pesticides.
Pendant longtemps, l’homme a utilisé des concoctions et préparations personnelles basées sur ses observations. Au milieu du XXe siècle, la chimie a révolutionné l’agriculture, permettant de reconstituer les stocks de céréales après deux guerres mondiales. Les pesticides de synthèse ont ensuite envahi nos foyers, éliminant blattes, fourmis, pucerons et moustiques.
Cependant, dès les années 1960, des lanceurs d’alerte ont mis en garde contre l’usage incontrôlé des organochlorés, qui fragilisaient les coquilles d’œufs d’oiseaux. Peu écoutés au début, ces précurseurs ont été suivis par des écologues, toxicologues et pharmaciens, qui ont constaté des anomalies dans la reproduction des oiseaux, reptiles et mammifères. Il est apparu que certains pesticides ne se dégradent pas et s’accumulent en haut des chaînes alimentaires.
L’homme, au sommet de ces chaînes, stocke les produits toxiques dans ses graisses et les transmet à sa progéniture pendant la grossesse ou l’allaitement. Les pesticides sont soupçonnés de causer des cancers de la prostate, leucémies et maladie de Parkinson, surtout chez les utilisateurs professionnels comme les agriculteurs et travailleurs en serre, notamment dans les pays moins développés. Les usages plus légers et diffusés pourraient aussi contribuer à certaines maladies.
La recherche progresse, tout comme l’espérance de vie. Il est essentiel de suivre les conseils de prudence des toxicologues et épidémiologistes, car les pesticides sont omniprésents dans notre vie. Avec quelques mesures de précaution, nous pouvons bénéficier de leurs avantages tout en évitant leurs inconvénients.
Partout et si nombreux
 Les insectes et autres parasites qui envahissent parfois les cultures au point de les détruire sont de véritables pestes. D'où le terme "pesticide", qui désigne les produits destinés à tuer ces hôtes indésirables, qu'il s'agisse d'insectes, de plantes ou de champignons.
Les insectes et autres parasites qui envahissent parfois les cultures au point de les détruire sont de véritables pestes. D'où le terme "pesticide", qui désigne les produits destinés à tuer ces hôtes indésirables, qu'il s'agisse d'insectes, de plantes ou de champignons.
Le mot "pesticides" englobe tous les produits, naturels ou de synthèse, utilisés pour lutter contre ces nuisibles. La peste, ce n’est pas seulement une maladie redoutable du Moyen Âge, mais aussi un terme général pour tout ce qui attaque les cultures : insectes nuisibles, acariens, champignons microscopiques, etc. C'est pourquoi on parle de "pesticides" pour désigner les produits qui protègent les champs et les serres de telles menaces.
Il existe différents types de pesticides : les biocides (produit à usage domestique et industriel, comme l’eau de javel ou les produits de protection de bois) et les produits phytopharmaceutiques (comme les herbicides). Tous contiennent des matières actives destinées à éloigner ou tuer la cible, ce qui les rend dangereux et à utiliser avec précaution.
Les herbicides, destinés à lutter contre les plantes indésirables, sont les plus connus. Les spécialistes préfèrent parler de plantes "adventices" ou indésirables, rappelant que chaque plante joue un rôle dans l'écosystème. Si une plante est déclarée "mauvaise", c’est parce qu’elle est malvenue dans un contexte de production spécifique, comme les champs de pommes de terre ou de légumes. Certains herbicides sont parmi les micropolluants les plus coûteux à éliminer par les distributeurs d’eau potable.
En plus des herbicides, on trouve les insecticides (contre les insectes, araignées et acariens), les fongicides (contre les champignons et lichens) et les rodenticides (contre les rongeurs).
Tous concernés
 Le marché des pesticides est en constante évolution. Les produits jugés nocifs pour la santé ou l'environnement sont retirés du marché, tandis que de nouvelles molécules, considérées généralement plus sûres, apparaissent. Cependant, les interdire ne suffit pas à s'en protéger. La prévention de leurs effets néfastes sur la santé incombe aux agriculteurs, aux particuliers et aux pouvoirs publics.
Le marché des pesticides est en constante évolution. Les produits jugés nocifs pour la santé ou l'environnement sont retirés du marché, tandis que de nouvelles molécules, considérées généralement plus sûres, apparaissent. Cependant, les interdire ne suffit pas à s'en protéger. La prévention de leurs effets néfastes sur la santé incombe aux agriculteurs, aux particuliers et aux pouvoirs publics.
En Belgique, de nombreuses substances actives (celles responsables de l'effet toxique sur la cible) ont été commercialisées depuis l'avènement des pesticides de synthèse. Un millier de formules commerciales ont été lancées, regroupées en quelques dizaines de familles selon leur composition : organochlorés, organophosphorés, pyréthrinoïdes, triazines, carbamates, etc.
Ces dernières années, la part des ménages dans l'achat de matières actives a diminué en Wallonie, avec une baisse de 28,7 % entre 2005 et 2010. Cette diminution n'est pas due à un changement de comportement, mais au retrait du marché des herbicides totaux, qui éliminent toutes les plantes sans distinction. Par unité de surface, les ménages utilisent environ quatre fois plus de pesticides dans les jardins et les parcs que les agriculteurs dans les champs. Malgré leurs efforts, les agriculteurs restent les principaux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en raison de l'importance des surfaces agricoles traitées.
Pourquoi parle-t-on tant des pesticides aujourd'hui ? Parce que leurs impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine sont de mieux en mieux connus. Ils sont omniprésents : dans l'air (extérieur et intérieur, poussières...), l'eau (souterraine et de surface), le sol, et les denrées alimentaires (sous forme de résidus). Les populations des pays riches y sont exposées en permanence, souvent à faible dose. Pour réduire cette exposition, il ne suffit pas d'interdire les produits les plus dangereux ou de les retirer du marché. Certains produits interdits depuis des décennies persistent dans l'environnement en raison de leur rémanence.
Par exemple, l'atrazine, un herbicide total systémique autrefois utilisé en culture de maïs et interdit depuis 2005 en Wallonie et en Europe, est encore détecté à des concentrations élevées dans les eaux souterraines de Wallonie. D'autres substances, comme le lindane interdit en 2001 et le diuron banni en 2007, sont également connues pour leur persistance et leur mobilité dans l'environnement. Les distributeurs d'eau se plaignent également de la présence de produits de dégradation, comme le 2,6-dichlorobenzamide (BAM) issu du dichlobénil, utilisé dans les jardins, sur les voiries, dans les cimetières, etc., ainsi que de nouvelles molécules (métolachlore, carbendazime), tout aussi difficiles à éliminer de l'eau pompée dans le sol ou les cours d'eau.
Risques pour la santé
 Les effets des pesticides sur la santé sont encore mal connus, mais les recherches récentes montrent que certains publics sont plus exposés que d'autres. Il est donc important de le savoir pour pouvoir se protéger.
Les effets des pesticides sur la santé sont encore mal connus, mais les recherches récentes montrent que certains publics sont plus exposés que d'autres. Il est donc important de le savoir pour pouvoir se protéger.
Les utilisateurs professionnels, notamment les agriculteurs, sont les plus à risque. Pour éviter une intoxication aiguë, ils doivent prendre des précautions lors de la manipulation des pesticides. La peau est la principale voie d'exposition, mais l'inhalation est également une source de risque lorsqu'ils préparent leurs mélanges
Les particuliers doivent aussi être vigilants, surtout lorsqu'ils utilisent des pesticides à l'intérieur, dans des espaces clos comme une serre ou une véranda, ou avec un spray ou un diffuseur en continu. Sans protection adéquate (masque, gants, vêtements longs), ils peuvent souffrir de nausées, vomissements, diarrhées, brûlures, convulsions, voire perte de conscience, ce qui constitue une intoxication aiguë.
Les pesticides ne sont pas que dans les champs : ils peuvent aussi se cacher dans nos maisons. Certains produits du quotidien, comme les shampooings anti-poux pour enfants ou les traitements antipuces pour animaux domestiques, contiennent des substances actives destinées à éliminer les parasites. Ce sont, par définition, des insecticides chimiques. Mais ce n’est pas tout : plusieurs de ces produits peuvent également contenir des perturbateurs endocriniens, des substances chimiques capables d’interférer avec notre système hormonal. Il est donc essentiel d’utiliser ces produits avec discernement.
Plusieurs maladies en cause
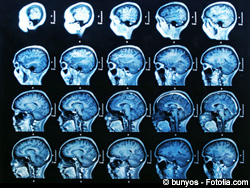 Une expertise collective de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale, France) a analysé les effets des pesticides sur la santé. Les données concernent les expositions professionnelles et précoces (fœtus et jeunes enfants). Des études plus récentes ont précisé les sous-types de pathologies (par exemple, différents types de leucémies), identifié les substances actives impliquées et investigué les populations supposées moins exposées, comme les riverains des zones agricoles.
Une expertise collective de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale, France) a analysé les effets des pesticides sur la santé. Les données concernent les expositions professionnelles et précoces (fœtus et jeunes enfants). Des études plus récentes ont précisé les sous-types de pathologies (par exemple, différents types de leucémies), identifié les substances actives impliquées et investigué les populations supposées moins exposées, comme les riverains des zones agricoles.
Les résultats de cette enquête de l’Inserm, mise à jour en 2021, révèlent que :
L'exposition prolongée et répétée à des doses réduites de pesticides augmente le risque de cancer de la prostate (de 12 à 28 %) pour les professionnels. Bien que les pesticides concernés soient interdits (chlordécone, carbofuran, coumaphos, perméthrine), les cancers peuvent se déclencher après une longue période de latence. Et encore, l’interdiction sur papier ne signifie pas forcément la fin de l’usage du produit sur le terrain. Ce risque concerne aussi les habitants des zones rurales. Les professionnels exposés régulièrement aux pesticides présentent également un risque accru de lymphomes non-hodgkiniens, myélomes multiples et leucémies.
Les pesticides peuvent causer des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson, reconnue comme maladie professionnelle dans le secteur agricole en France. Le lien est établi avec les insecticides (organochlorés) et herbicides, mais pas avec les fongicides. Les études récentes montrent un lien fort entre l'exposition professionnelle aux pesticides et les troubles cognitifs, la bronchopneumopathie chronique obstructive et la bronchite chronique. Une présomption moyenne de lien est établie avec la maladie d'Alzheimer, les troubles anxio-dépressifs, certains cancers (leucémies, système nerveux central, vessie, rein, sarcomes des tissus mous), l'asthme et les pathologies thyroïdiennes. Pour les Lymphomes non-hodgkinien, il existe une présomption forte avec des substances actives (malathion, diazinon, lindane, DDT) et avec une famille chimique de pesticides (organophosphorés).
Les femmes exposées professionnellement aux pesticides courent un risque accru de fausse-couche et de malformations congénitales. Les femmes vivant près des zones agricoles sont également à risque de malformations congénitales. Un lien a été établi entre l'exposition professionnelle paternelle en période pré-conceptionnelle et le risque de leucémie aiguë lymphoblastique. Les études récentes sur les pyréthrinoïdes montrent un lien entre l'exposition pendant la grossesse et les troubles du comportement, tels que l’anxiété́, chez les enfants. Les enfants de ces agricultrices peuvent présenter une diminution de la motricité fine, de l'acuité visuelle ou de la mémoire récente. Les études récentes signalent un risque accru de leucémie et de tumeurs cérébrales chez les enfants d'agricultrices.
Rappelons que la plupart de ces effets sont attribués à des molécules aujourd’hui interdites. En outre, la qualité du lait maternel en Wallonie s'est améliorée entre 1988 et 2008 par rapport aux polluants organiques persistants (POP), dont certains pesticides.
Le lien entre certains pesticides interdits et les troubles de la fertilité chez l'homme est établi, mais pas pour les pesticides actuels ni pour l'infertilité féminine.
Les riverains des zones agricoles peuvent être affectés par la dérive des produits épandus sur les cultures. Des études suggèrent un lien entre l'exposition des riverains et la maladie de Parkinson, ainsi que des troubles du spectre autistique chez l'enfant.
Alternatives
 Il existe bien des astuces pour éviter les produits anti-insectes et anti-mauvaises herbes. Il s’agit des méthodes alternatives, ingénieuses et souvent peu onéreuses pour protéger notre environnement et notre santé, tout en préservant nos cultures des envahisseurs, sans recourir aux herbicides et insecticides.
Il existe bien des astuces pour éviter les produits anti-insectes et anti-mauvaises herbes. Il s’agit des méthodes alternatives, ingénieuses et souvent peu onéreuses pour protéger notre environnement et notre santé, tout en préservant nos cultures des envahisseurs, sans recourir aux herbicides et insecticides.
Parmi ces méthodes :
- Choisir des matériaux adaptés pour l'aménagement des sentiers.
- Adopter des pratiques de tonte du gazon réfléchies.
- Utiliser des techniques de couverture du sol dans les potagers.
- Installer des moustiquaires.
Si les envahisseurs persistent, des techniques de lutte alternatives peuvent réduire l'utilisation de produits toxiques :
- Désherbage manuel ou thermique, utilisation de produits plus naturels et/ou moins nocifs.
- Recours à des méthodes traditionnelles et modernes à base de plantes ou de savons naturels.
Pour plus d’information
- Les conseils de l'ASBL Adalia pour jardiner sans pesticides qui vous propose des solutions alternatives adaptées à vos besoins
- La fiche de Santé-Habitat « Je peux éviter d’utiliser des pesticides à la maison »
- La brochure du SPF Santé, Environnement, Sécurité de la chaîne alimentaire « Biocides et pesticides : pas sans risques! »
- Le Plan Maya – Bee Wallonie de la Wallonie qui donne à présent l'opportunité aux particuliers d'agir en faveur des insectes pollinisateurs dans leur propre jardin.
- La brochure développée par Canopea et subsidiée par la Wallonie "Des pesticides à domicile : comment s'en protéger ?"
Nos assiettes, dangereuses pour la santé ?
 Les contrôles réguliers des denrées alimentaires avant leur mise en vente révèlent peu de dépassements des normes de résidus de pesticides. Cependant, il est important de rester prudent et d'adopter une alimentation aussi saine que possible, ce qui n'est pas toujours facile.
Les contrôles réguliers des denrées alimentaires avant leur mise en vente révèlent peu de dépassements des normes de résidus de pesticides. Cependant, il est important de rester prudent et d'adopter une alimentation aussi saine que possible, ce qui n'est pas toujours facile.
Pour la majorité de la population, l'exposition aux pesticides se fait principalement par l'alimentation. Nous ingérons tous des résidus de pesticides, même dans les produits bio (pas à l'abri de contaminations historique ou autre), bien que de manière infinitésimale.
Les laboratoires peuvent désormais détecter des quantités infimes de polluants dans nos aliments et boissons, équivalentes à 5 grammes de produit dilués dans 30 millions de litres, soit un morceau de sucre dans 10 piscines olympiques.
Les enfants nécessitent une vigilance particulière car ils sont plus fragiles et souvent exposés aux pesticides au niveau du sol : herbicides dans les parterres, appâts anti-insectes, colliers antipuces des animaux de compagnie, etc. Malgré cela, les études sur les résidus de pesticides dans notre alimentation sont globalement rassurantes. En 2022, en Belgique, les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides n'ont été dépassées que dans 2,4 % des cas, selon l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA).
Pourquoi tant de polémiques sur les effets des pesticides sur notre santé ?
- Certains scientifiques contestent la manière dont les normes sont fixées, même avec les marges de sécurité pour les enfants et les personnes vulnérables.
- L'effet "cocktail" de certains pesticides, associés à des additifs alimentaires, est un vaste champ de recherche encore peu exploré.
- Il est difficile d'isoler l'exposition aux pesticides d'autres variables liées au style de vie ou à l'hérédité dans les maladies multifactorielles comme le cancer.
- La toxicologie évolue et certains de ses fondements historiques sont aujourd'hui discutés.
Le moment de l'exposition à un produit chimique peut être aussi important, voire plus, que la quantité à laquelle on est exposé. Cela est particulièrement reconnu pour les perturbateurs endocriniens, dont certains pesticides font partie. Certains scientifiques soupçonnent même des effets transgénérationnels liés à des phénomènes épigénétiques, pouvant expliquer certaines formes d'obésité ou de diabète. La science doit encore progresser avant de tirer des conclusions définitives.
Pour limiter son exposition aux pesticides via l'alimentation, il est recommandé de
- Éviter les produits alimentaires issus de cultures utilisant des pesticides.
- Consommer de préférence des fruits et légumes non traités (par exemple, cultivés dans votre potager) ou biologiques.
