Bruit
 Dans les enquêtes relatives à la santé et à la qualité de vie, le bruit est généralement cité comme l’une des principales nuisances environnementales. Les activités festives (boîtes de nuit, concerts, etc.) sont évidemment à la source de nombreuses plaintes.
Dans les enquêtes relatives à la santé et à la qualité de vie, le bruit est généralement cité comme l’une des principales nuisances environnementales. Les activités festives (boîtes de nuit, concerts, etc.) sont évidemment à la source de nombreuses plaintes.
Mais les différentes formes de trafic (routier, aérien, ferroviaire) mettent aussi nos tympans à rude épreuve. Tous, ou presque, nous participons à ce qui fait la gêne du voisin.
Dès lors, par où commencer ? Etouffer le bruit dès la source? Limiter sa propagation via des aménagements techniques? Travailler le sens civique de la population? Les trois pistes sont à suivre, probablement !
Le bruit, source de pollution sous-estimée
 Le bruit ? Tout le monde s’en plaint ! Surtout à propos du trafic. Suscitant l’indifférence chez les uns, l’irritation extrême chez les autres, soumis pourtant aux mêmes sons, le bruit est difficile à combattre.
Le bruit ? Tout le monde s’en plaint ! Surtout à propos du trafic. Suscitant l’indifférence chez les uns, l’irritation extrême chez les autres, soumis pourtant aux mêmes sons, le bruit est difficile à combattre.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’impact sonore du trafic, essentiellement automobile, fait perdre un million d’années de vie en bonne santé aux Européens de l’Ouest. Troubles du sommeil, problèmes de concentration, troubles de l’apprentissage et de l’humeur : tel est le prix que nous payons à un environnement sonore dégradé. Et c’est sans compter la contribution du bruit à des maladies plus graves, comme la dépression, l’hypertension ou les troubles cardiaques.
Dans la plupart des pays européens, le bruit est cité comme la nuisance environnementale numéro 2, juste après la pollution atmosphérique. Dans les grandes villes, il occupe souvent le haut du podium. Interrogés en 2004 dans le cadre d’une grande enquête nationale (ISSP), environ 10 % des Wallons se sentaient incommodés par le bruit du trafic jusqu’à l’intérieur de leur domicile.
Certes, les bruits intempestifs, ceux qui nous agacent ou qui transforment carrément nos temps de repos en cauchemars, ne sont pas seulement l’affaire du trafic. Les troubles de voisinage sont également répertoriés en bonne place dans les enquêtes d’opinion, même s’ils sont plus difficilement objectivables. Mais le bruit lié à la circulation a la particularité de frapper davantage les populations précarisées, plus souvent implantées à proximité des voies de communication ou d’industries bruyantes que la moyenne de la population.
Malgré ce tableau interpellant, la lutte contre le bruit progresse assez lentement en Europe. Peut-être parce que ses effets négatifs ne se font pas nécessairement sentir directement. A l’inverse d’autres formes de pollution, le bruit n’éveille pas les mêmes inquiétudes que l’air et l’eau. Il ne laisse pas d’images ni de traces aussi visibles qu’une rivière remplie de poissons morts ou une « cloche » de pollution brunâtre au-dessus d’une ville.
Et puis le bruit - matière très subjective - (lire : « Sons, bruits, hertz, décibels : de quoi parle-t-on ? ») ne cesse de questionner la notion de civisme. C’est, en effet, le bruit de l’autre qui nous gêne généralement, même si nous pratiquons à d’autres moments les mêmes activités que lui : conduite automobile, tonte du gazon, pratique de loisirs bruyants, etc.
Son, bruit, hertz, décibels : de quoi parle-t-on?
 Le bruit est une notion à la fois complexe et soumise à la subjectivité de chacun.
Le bruit est une notion à la fois complexe et soumise à la subjectivité de chacun.
Le bruit est un ensemble complexe de sons présentant des fréquences et des intensités différentes. Ces sons correspondent à des variations de pression de l’air ambiant qui, stimulant la membrane du tympan, sont transmis sous une forme mécanique jusqu’à l’oreille interne. Là se créent des messages électriques qui sont transmis au cerveau.
L’unité de fréquence du son est le hertz (Hz). Celui-ci représente le nombre de vibrations (oscillations) du son par seconde. Une oreille humaine en bonne santé perçoit les sons entre 20 Hz (basses fréquences) et 20.000 Hz (hautes fréquences).
L’unité d’intensité du son, elle, est le décibel. On utilise souvent le dB(A), qui est l’unité de niveau sonore qui tient compte des particularités de perception de l’oreille humaine. L’échelle des décibels est une échelle logarithmique. Ainsi, 3 décibels supplémentaires correspondent au doublement de l’énergie sonore, 5 décibels au triplement et 10 décibels à sa multiplication par dix. A noter, enfin : les décibels ne s’additionnent pas.
Ainsi, deux machines à laver d’un niveau sonore de 60 décibels ne créent pas un bruit de 120 décibels, mais de 63 décibels.
- Le murmure se situe à 20 dB(A), une conversation normale à 50 dB(A).
- Les bruits gênant commencent à 85 dB(A), soit le niveau d’une piscine publique couverte. A savoir que la qualification « gênantes » ou non du bruit dépend aussi des circonstances. Pour éviter la gêne en zone d’habitat la nuit, cette limite fixée aux industries est de 40dB(A). Pour mémoire, l’OMS définit la gêne comme « la sensation de désagrément, de déplaisir provoquée par un facteur de l’environnement dont l’individu ou le groupe connaît – ou imagine – le pouvoir d’affecter sa santé ».
- Les sons fatigants (du mixer à la moto en phase d’accélération) vont de 90 à 100 dB(A).
- Les bruits dangereux (le lecteur mp3 poussé à fond et le groupe rock en concert) vont de 105 à 110 dB(A)).
- Le seuil de la douleur, enfin, débute à 115 dB(A) : bruit de métal sur l’acier, moteur de formule 1 (120 dB(A)), avion à réaction (130 dB(A)), etc.
Tout dépend bien évidemment de la distance à laquelle on se trouve de la source. Le bruit gênant est une notion éminemment subjective. Le bruit du voisinage, par exemple, n’est pas toujours d’un niveau très élevé, mais dérange par son côté intrusif et, éventuellement, par son identification à un individu ou un groupe d’individus. Un bruit choisi est moins gênant qu’un bruit subi ; un bruit prévisible moins gênant qu’un bruit imprévu. La gêne dépend d’une multitude de facteurs, dont l’âge et les antécédents de chacun, mais aussi du caractère répétitif ou non du bruit, du moment de la journée perturbé, de la capacité – ou non – à le maîtriser ou le faire cesser.
Le bruit, un impact très varié sur la santé
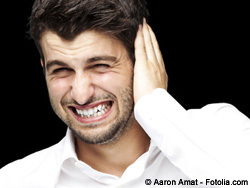 Le bruit intempestif n’affecte pas seulement le sommeil. Il a aussi des impacts sur le fonctionnement de notre cœur, nos hormones, notre immunité…
Le bruit intempestif n’affecte pas seulement le sommeil. Il a aussi des impacts sur le fonctionnement de notre cœur, nos hormones, notre immunité…
Qui n’est jamais sorti d’un environnement sonore éprouvant (concert, boîte de nuit, cantine ou réception très bruyante…) avec cette impression de ne plus bien entendre une conversation à voix normale? Cette mauvaise perception est qualifiée par les spécialistes de « fatigue auditive ». En général, il suffit de quelques minutes ou quelques heures pour récupérer une capacité auditive normale. Mais l’exposition prolongée et répétée à un niveau proche du seuil de la douleur (tel qu’on le rencontre parfois dans les lieux de loisirs musicaux : 105, voire 110 dB(A) (Lire : « Sons, bruit, hertz, décibels : de quoi parle-t-on?) peut entraîner un dommage bien plus conséquent : des acouphènes (sifflements intempestifs), voire la surdité.
Chacun ne sera pas frappé de la même manière : tout est affaire de sensibilité individuelle, mais aussi de durée et d’intensité d’exposition. La prudence est de mise, car la perte d’acuité auditive passe longtemps inaperçue ! Dans un premier temps, elle ne concerne que les fréquences les plus aiguës. Ce n’est que lorsqu’elle frappe les fréquences plus basses (500 à 2000 Hz) qu’elle se montre vraiment invalidante pour la compréhension d’autrui.
Les effets du bruit ne limitent pas à la sphère auditive. En d’autres termes, il n’y a pas que l’oreille qui « encaisse » :
Sommeil
L’effet biologique le plus connu est l’atteinte au sommeil. Absorbant en moyenne un tiers de notre vie, celui-ci est censé nous permettre de récupérer nos forces physiques et mentales. Il en va tout autrement lorsque des nuisances sonores s’attaquent à notre sommeil. Le bruit peut évidemment retarder la phase d’endormissement ou empêcher toute nouvelle plongée dans le sommeil après une phase de réveil. Mais il peut aussi entraîner des modifications dans les différentes phases du sommeil (sommeil paradoxal, sommeil profond…) qui, là non plus, ne sont pas nécessairement perçues par le dormeur. Les conséquences potentielles sont nombreuses : irritabilité, somnolence, réduction des performances, anxiété, hausse du risque d’accident, etc.
Santé cardio-vasculaire
L’exposition à des niveaux élevés de bruit peut aussi provoquer des désordres cardio-vasculaires. Elle entraîne une augmentation de la sécrétion des hormones liées au stress, ce qui peut bouleverser le système cardio-circulatoire : troubles du rythme cardiaque, augmentation du métabolisme des graisses, etc. Le risque de maladies cardiovasculaires augmente de 20 % chez les personnes exposées à des niveaux sonores moyens de 70 dB(A) par rapport à celles vivant en zones calmes, soit 60 dB(A)). Le fœtus lui-même peut être affecté par les modifications cardio-vasculaires et hormonales de sa mère, par exemple lorsque celle-ci exerce sa profession dans un environnement sonore de plus de 85 dB(A) (soit le niveau sonore d’une piscine couverte).
Défenses immunitaires
Le bruit peut également entraîner une diminution des défenses immunitaires et, par conséquent, une fragilité accrue à diverses formes d’agression de l’organisme. Il est considéré, enfin, comme l’un des facteurs susceptibles de contribuer à déclencher une dépression ou à l’aggraver.
Le bruit wallon mis en carte
 Que ce soit autour des aéroports, le long des axes routiers et ferroviaires, la Wallonie dispose d'une information assez précise du nombre de personnes soumises aux différents niveaux de bruit.
Que ce soit autour des aéroports, le long des axes routiers et ferroviaires, la Wallonie dispose d'une information assez précise du nombre de personnes soumises aux différents niveaux de bruit.
Environ 740.000 personnes, en Wallonie, sont concernées par le bruit le long des grands axes routiers. Pour arriver à de tels résultats, des cartes basées sur les autoroutes dont le trafic automobile dépasse 6 millions de passages de véhicule par année, soit 1.060 kilomètres d’autoroutes ont été dressées. Sur ces axes, plus de 500.000 personnes sont exposées à des niveaux moyens ou supérieurs à 55 dB(A). Ce qui, selon la littérature scientifique, est susceptible de causer une gêne dans la vie quotidienne de 20% de la population exposée.
En ce qui concerne le rail, près de 60.000 Wallons sont gênés par la circulation ferroviaire le long des axes ayant un trafic supérieur à 60.000 passages annuels. Cette gêne, sensiblement moindre que le trafic routier, n’est pas une surprise. Déjà en 2004, une enquête fédérale de santé avait estimé à 2 % de la population belge le nombre de plaignants envers l’impact sonore du trafic ferroviaire, alors qu’ils étaient cinq fois plus nombreux (10 %) à se plaindre de la circulation automobile.
Les tronçons ferroviaires concernés totalisent une distance de 131 kilomètres. Ils sont situés dans les agglomérations de Liège et de la Louvière ; il s’agit aussi des lignes Bruxelles/Braine-le-comte, Bruxelles/Braine l’Alleud, Bruxelles/Gembloux et Namur/Charleroi. Près de 61.000 habitants sont exposés le long de ces voies à des niveaux sonores supérieurs à 55 dB(A). Mais 49.000 de ceux-ci sont exposés, la nuit, à un niveau sonore supérieur à 50 dB(A). Les lignes de chemin de fer ont la particularité de pénétrer des zones densément peuplées, traversant villes et villages. Dans ces zones, les habitations riveraines forment souvent un front bâti (bâtiments mitoyens) qui fait écran à la dissémination du bruit. Et c’est sans parler des problèmes de vibrations, qui viennent amplifier la stimulation sonore. Lors des calculs ayant permis l’élaboration des cartes mentionnées ci-dessus, des corrections ont été appliquées pour tenir compte de la gêne supplémentaire occasionnée aux périodes sensibles, par exemple entre 19 et 23 heures.
A l’heure actuelle, les deux grands aéroports wallons (Charleroi et Liège) ne sont pas encore concernés par la législation imposant ces cartes de bruit. Le nombre de vols enregistrés est, en effet, trop bas au regard de la législation européenne. Dès qu’ils dépasseront 50.000 mouvements annuels (hors vols d’instruction ou d’écolage), ils seront tenus de réaliser cette cartographie du bruit. Actuellement, dans le cadre du suivi des aéroports de Liège et Charleroi, la Wallonie dispose de cartographies acoustiques. Rien n’est encore prévu sur le plan cartographique, à l’heure actuelle, pour les petits aéroports ni pour les installations accueillant des ULM ou des paramoteurs. Dans les zones autour de Liège et Charleroi, diverses mesures d’accompagnement ont été mises en place dans le cadre de Plans d’exposition au bruit (PEB) (voir «La Wallonie se mobilise contre le bruit »)
Les indicateurs de l'état de l’environnement wallon
- Exposition au bruit du trafic routier
- Exposition au bruit du trafic ferroviaire
- Exposition au bruit du trafic aérien
La Wallonie se mobilise contre le bruit
 Identifier les points noirs sur le territoire et y déployer une batterie de solutions techniques.
Identifier les points noirs sur le territoire et y déployer une batterie de solutions techniques.
En conséquence d’une directive européenne de 2002, la Wallonie a élaboré une première cartographie du bruit en 2008. Celle-ci concerne, à ce stade, le bruit situé le long des axes routiers et ferroviaires fréquentés par un trafic à haut débit (6 millions de passages de véhicules par an pour le trafic routier, 60.000 pour le trafic ferroviaire). Elles reposent sur des niveaux sonores considérés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme des « gênes » pour une partie de la population.
Le but de ces cartographies consiste à identifier les points noirs et d’y développer des plans d’action. Ces derniers seront modulés en fonction du nombre de personnes exposées au bruit et basés sur une panoplie de mesures techniques: remplacement des revêtements routiers les plus bruyants, installation de panneaux antibruit, érection de talus de terre ou de barrières de végétation, etc.
A terme, une cartographie est envisagée pour les axes routiers fréquentés par 3 millions de véhicules par an et les axes ferroviaires fréquentés par 30.000 passages de convois par an. Les cartographies pour les villes de Liège et de Charleroi, intégrant les diverses sources sonores dont les sources industrielles, seront finalisées au cours de l’année 2014 et elles seront accessibles sur le Géoportail de la Wallonie.
L’Agence européenne de l’environnement estime possible d'obtenir une diminution de 5 dB(A) dans la plupart des situations à problème en Europe en travaillant sur les points suivants : révision des normes de bruit, renforcement de l’inspection technique, amélioration de la qualité des pneus et des revêtements routiers (un enrobé drainant permet de réduire le bruit de 5 à 8 % tout en améliorant la sécurité routière), amélioration de la gestion du trafic (limitations de vitesse, coordination des feux de signalisation…), etc.
La diminution globale du trafic, elle, semble moins pertinente ; du moins, elle devrait atteindre au moins 40 % pour que les niveaux de bruit baissent significativement. Or, entre1990 et 2009, les déplacements de personnes en Wallonie ont augmenté de 40 %, la route occupant une place toute privilégiée…
En ce qui concerne le réseau ferroviaire, c’est le travail sur les trains de marchandises qui est prioritaire. En effet, ils présentent des convois plus longs, plus lourds et exigeants de plus longues distances de freinage que les trains de voyageurs. L’une des voies suivies consiste à remplacer les blocs de freins en fonte par des matériaux composites. Depuis la libéralisation du transport de marchandises par rail (2007), la plupart des mesures de ce genre sont toutefois soumises à des décisions européennes. En ce qui concerne les équipements antibruit gérés par Infrabel, 91 kilomètres en étaient dotés en 2008, soit un peu moins de 3 % du réseau ferroviaire belge.
En ce qui concerne les aéroports, la directive n’impose aucune cartographie à ce stade. La population exposée aux deux principales installations (Liège/Bierset et Charleroi/Gosselies) concerne respectivement 11.222 et 9.594 habitations. La population résidant dans les zones A (càd exposée à une intensité sonore supérieure à 70 dB(A)) constitue respectivement 5 et 2 % de l’ensemble de la population exposée aux nuisances sonores. A partir de 2004, les Plans d’exposition au bruit (PEB) ont permis d’offrir des mesures d’accompagnement facultatives aux riverains les plus incommodés : insonorisation ou procédure de rachat par la Wallonie. A la date du mois d’août 2009, 88 % des habitations concernées par les PEB en avaient fait la demande à Liège, et 44 % à Charleroi. A Liège, par exemple, 27,1 % des habitations ont été rachetées par les pouvoirs publics ou sont en voie de l’être et 67 % ont été insonorisées ou sont en cours d’insonorisation. A Charleroi, le rachat concerne 4,1 % des habitations du PEB, et l’insonorisation 40 %. Le budget global affecté à ces opérations s'est élevé à 500 millions d’euros (entre 2004 et 2014). Des mesures d’encadrement (limitation du bruit à la source) sont également en vigueur : restrictions horaires, exclusion de certains appareils, contrôles des émissions sonores.
