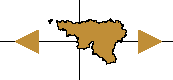|
[ Consultez les données actualisées ]
 Description du phénomène
Description du phénomène
La science et
la technologie ont beaucoup amélioré notre niveau de vie.
Celui-ci ne serait pas ce qu’il est sans cette large gamme de produits
de consommation courante que nous considérons comme essentiels.
Mais la fabrication et l’utilisation de ces produits engendrent
fréquemment des déchets dangereux qu’il faut traiter
afin de minimiser les risques pour la santé et l’environnement.
Les déchets
dangereux sont inventoriés et identifiés. Ils ne peuvent,
en principe, être mélangés ni entre eux, ni avec
des déchets non dangereux. Des mélanges peuvent toutefois
être réalisés si cela permet d’augmenter la
sécurité de la collecte ou du transport sans compromettre
l’efficacité ou la sécurité de l’élimination
ou de la valorisation. Les déchets dangereux font l’objet
de dispositions spécifiques de gestion, qui sont éventuellement
encore précisées si la nature des déchets l’exige.
C’est le cas, par exemple, pour les huiles usagées, les
déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane, les
PCB (polychlorobiphényles) ou PCT (polychloroterphényles),
les déchets animaux, les déchets d’activités
hospitalières et de soins de santé. En effet,
- les huiles usagées
constituent, si elles ne sont pas collectées et traitées
de façon satisfaisante, une menace importante pour l’environnement
en raison notamment de leur aptitude à s’étendre
à la surface des eaux empêchant alors les transferts
gazeux entre l’air et l’eau ;
- les rejets
de l’industrie du dioxyde de titane contiennent souvent un grand
nombre de matières toxiques ;
- les produits
à base de PCB et de PCT présentent des risques de pollution
froide en cas de fuite. N’étant pas biodégradables,
les PCB peuvent polluer les nappes phréatiques et entraîner
des risques d’intoxication pour l’homme. De même,
des risques de pollution chaude sont aussi à craindre en cas
d’incendie. En effet, bien qu’ininflammables, les PCB se
consument autour de 500°C, dégageant alors des dioxines
et furanes toxiques. Pour toutes ces raisons, leur emploi a donc été
progressivement réglementé ;
- les déchets
animaux peuvent présenter des risques sérieux de propagation
de maladies transmissibles aux animaux ou à l’homme ;
- les déchets
d’activités hospitalières et de soins de santé
présentent des risques de contamination microbienne.
 Signification
Signification
La pression des
déchets dangereux sur l’environnement est fonction de la
quantité et du degré de dangerosité. Cet indicateur
permet d’évaluer si la capacité des installations
de gestion mise en place en Région wallonne est suffisante et
est adaptée aux quantités produites pour chaque type de
déchets dangereux. Il permet aussi d’évaluer le progrès
accompli en matière de substitution de matières dangereuses
dans les produits (peintures à l’eau, colles naturelles,
piles sans mercure, appareils sans PCB/PCT, etc).
 Situation en Région wallonne
Situation en Région wallonne
En général,
l’augmentation significative des tonnages de déchets dangereux
déclarés de 1995 à 1998 (Figure 5-14) s’explique
par un recours plus systématique des entreprises aux services
des collecteurs agréés en général pour tous
les déchets dangereux et par une augmentation des collectes de
déchets animaux et de déchets hospitaliers. En outre,
les détenteurs de déchets, en cas de doute sur le caractère
dangereux ou non d’un déchet, le déclarent aujourd’hui
comme déchet dangereux alors que cette pratique était
moins fréquente il y a quelques années.
Figure
5-14 : Evolution des quantités de déchets dangereux
en Région wallonne (1995-1998).
Source : Ministère de la Région wallonne, DGRNE.
Le total des déchets
dangereux déclarés en Région wallonne en 1998 atteint
475 ktonnes, dont près de 90 ktonnes (19 % du total) sont des
déchets animaux, 32 ktonnes (7 %) sont des huiles usagées,
3 ktonnes (1 %) sont des déchets hospitaliers et 0,6 ktonnes
des PCB/PCT (Figure 5-15).
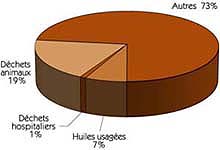
Figure 5-15 : Part relative de certains déchets dangereux déclarés
en 1998.
Source : Ministère de la Région wallonne, DGRNE.
Les autres déchets
dangereux, soit 348 ktonnes (73 % du total), sont principalement des
déchets de la sidérurgie (plus de 86 ktonnes, soit 18
%), des résidus légers de broyage de véhicules
(47 ktonnes) et des solutions de décapage acide (35 ktonnes).
Il faut signaler aussi que 18 ktonnes de terres polluées ont
été gérées en 1998.
 Situation wallonne dans le contexte européen
Situation wallonne dans le contexte européen
La quantité
de déchets dangereux générée par an et par
habitant dans différents pays européens varie entre 20
et 400 kg 22 .
Malgré le fait que la Région wallonne soit dotée
d’une industrie chimique relativement importante, la génération
de déchets dangereux en Région wallonne ne représente
qu’environ 145 kg par habitant. Compte tenu des variations entre
les différentes définitions, classifications, terminologies
et compositions du gisement de déchets des différents
pays, ces données doivent être comparées avec prudence. .
Malgré le fait que la Région wallonne soit dotée
d’une industrie chimique relativement importante, la génération
de déchets dangereux en Région wallonne ne représente
qu’environ 145 kg par habitant. Compte tenu des variations entre
les différentes définitions, classifications, terminologies
et compositions du gisement de déchets des différents
pays, ces données doivent être comparées avec prudence.
Les quantités
de déchets dangereux exprimées «par habitant»
sont malheureusement les seules données actuellement disponibles
; or, comme il s’agit de déchets industriels, ce ratio n’a
guère de sens.
|
Conclusion
L’augmentation
apparente de la quantité estimée de déchets
dangereux est due à une amélioration de la collecte
et du registre de déchets plutôt qu’à
une réelle augmentation de la génération
de ces déchets. En tout cas, une augmentation de la quantité
de déchets dangereux révèle la nécessité
d’agir sur le cycle de vie complet des produits. Ce challenge
dépasse bien évidemment le cadre de la seule Région
wallonne. La tendance dans les années à venir devra
confirmer une stabilisation de la génération de
déchets dangereux comme conséquence des progrès
technologiques en matière de substitution des matières
dangereuses.
|
Lien direct
avec d’autres indicateurs
DecP4
: Evolution des quantités de déchets industriels
DecP5 : Traitement des déchets industriels
DecP6 : Traitement des déchets dangereux
DecP8 : Transferts transfrontaliers de déchets
dangereux
Caractérisation
des données
L’inventaire
de la production des déchets dangereux est établi à
partir :
- des formulaires
de déclaration de production et/ou de détention de déchets
dangereux qui sont transmis semestriellement par les acteurs concernés
à l’Office wallon des déchets ;
- des relevés
trimestriels des opérations effectuées par les collecteurs
et les centres de traitement agréés pour les déchets
dangereux ;
- des déclarations
mensuelles des exploitants des CET de déchets dangereux (classe
5.1.) ;
- des déclarations
relatives aux transferts transfrontaliers de déchets.
On peut estimer
que les données en provenance des centres de traitement et des
collecteurs permettent d’avoir une vision globale assez précise
et correcte des quantités de déchets dangereux en Région
wallonne et que les déchets dangereux non répertoriés
concernent plus particulièrement ceux produits en petites quantités
ou qui ne seraient pas encore gérés dans les filières
adéquates.
Les statistiques
annuelles établies depuis 1995 indiquent une augmentation des
quantités déclarées. Cette augmentation n’est
pas liée à une croissance de la production de déchets
dangereux mais bien à l’amélioration du système
de déclaration, au traitement informatique des données
ainsi qu’à l’envoi régulier par l’administration
des formulaires de déclaration aux acteurs concernés.
A partir de l’année
1998, la nomenclature jusque là utilisée pour classer
les déchets dangereux, c’est-à-dire l’AERW du
23 décembre 1992, a été remplacée par le
catalogue européen des déchets 23 . .
Aspects
réglementaires
Le tableau
présente les principaux outils réglementaires existants
en ce qui concerne les déchets dangereux aux niveaux européen
et wallon.
Relation
avec le PEDD
Cahier 4 : Les
déchets (pas d’actions spécifiques)
Gestionnaire(s)
des données
MERCIER Jean-Yves
Rédacteur(s)
LOPEZ Maria Jose
PLANCHON Anne
|
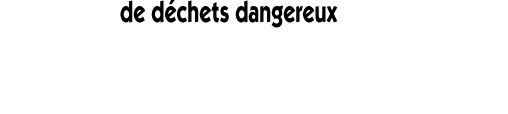
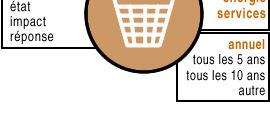
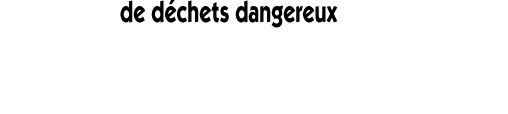
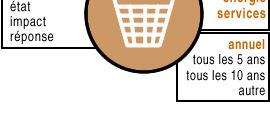
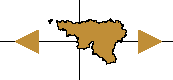
![]() .
.