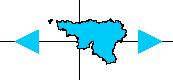L’atmosphère terrestre est une composante fondamentale de la vie sur terre : d’une part sa teneur en oxygène permet la respiration des organismes vivants et d’autre part, de par sa composition, elle est perméable aux rayonnements solaires bénéfiques à la vie terrestre mais ne permet pas le transfert d’autres rayonnements néfastes (notamment une grande part des rayons ultraviolets solaires). En outre, elle piège une grande partie du rayonnement thermique infrarouge émis par la terre elle-même. Cet effet de serre naturel permet de maintenir sur terre, une température moyenne compatible avec la vie.
L’atmosphère se décompose en différentes couches caractérisées notamment par des profils de températures qui leur sont propres :
- la troposphère, où se déroulent les phénomènes météorologiques et où, la plupart des polluants sont émis et se dispersent. Elle s’étend du sol jusqu’à 10 à 15 km selon la latitude. La température moyenne y décroît progressivement de 15°C au niveau du sol à –55°C à son sommet. On y distingue également la couche de mélange allant du niveau du sol à quelques centaines de mètres, caractérisée par une turbulence de l’air due à la rugosité du sol ;
- la stratosphère s’étend depuis le sommet de la troposphère jusqu’à une altitude de l’ordre de 50 km. La température s’y accroît jusqu’à atteindre 0°C à 50 km
- d’altitude. La stratosphère renferme la couche d’ozone ;
- au-delà de ces deux couches on distingue également, la mésosphère, la thermosphère et l’ionosphère.
A elles-seules, la troposphère et la stratosphère renferment 99 % de la masse gazeuse et, ce sont ces deux compartiments qui sont principalement et le plus directement le siège des perturbations liées à l’activité humaine. Ces perturbations se caractérisent par des échelles de temps et d’espace différentes. Selon un niveau d’échelle (géographique et temporel) de plus en plus petit, on peut distinguer successivement :
- les perturbations climatiques liées aux émissions de gaz à effet de serre,
- la destruction de la couche d’ozone liée aux émissions de substances halogénées,
- la pollution par des substances acidifiantes,
- la production d’ozone dans la troposphère suite à certaines émissions et à l’action des rayonnements ultraviolets,
- l’accumulation de substances toxiques dans certains écosystèmes suite à leur émission et à leur transport à grande échelle pour certaines d’entre elles,
- les retombées locales de substances telles que poussières ainsi que la présence de particules fines en suspension ayant un impact sur la santé humaine.
La description quantitative de ces perturbations, mais aussi des pressions à l’origine de celles-ci et des réponses mises en œuvre pour réduire ces pressions est faite dans ce chapitre, au travers d’une série d’indicateurs représentatifs des différentes problématiques citées ci-dessus.
Les pressions exercées sur l’équilibre climatique de la terre sont liées aux émissions de différents gaz dont la propriété est d’absorber le rayonnement infrarouge résultant de l’échauffement de la surface terrestre par l’énergie solaire. Ces gaz dits à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et autres gaz industriels) sont émis par différentes activités humaines. L’évolution des émissions, à la hausse dans la plupart des pays industrialisés, devrait pourtant être ramenée à la baisse à court et à plus long terme pour éviter que se manifestent des changements climatiques rendant la vie sur terre de plus en plus difficile.
Ces émissions, leur évolution et leur répartition entre les différents secteurs d’activité qui les génèrent sont décrites dans l’indicateur AirP1 «Emissions de gaz à effet de serre».
L’influence des activités humaines sur la couche d’ozone stratosphérique continue à se marquer, principalement au-dessus de l’Antarctique où un trou a commencé à apparaître au début des années 80. De légères diminutions de son épaisseur ont également été observées aux latitudes moyennes. Les substances à l’origine de cette destruction sont des substances chlorées (CFC, HCFC par exemple) ou bromées (bromure de méthyle). Leurs émissions au niveau mondial ont fortement diminué depuis 1988 suite au Protocole de Montréal. Mais leur temps de résidence dans l’atmosphère explique leur action destructrice longtemps après leur émission dans l’atmosphère.
La description de ce phénomène et les émissions wallonnes des substances incriminées est réalisée au niveau de l’indicateur AirP2 «Emissions de gaz appauvrissant la couche d’ozone».
L’acidification de l’environnement est principalement due aux retombées liées aux émissions de trois polluants : le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et l’ammoniac. Une partie de ces émissions retombe au sol sans modification chimique, une autre sous forme acide. L’impact de ces retombées se marque sur les eaux de surface et sur la végétation et dépend à la fois des quantités déposées mais également de la nature des sols.
Dans l’ensemble, les émissions acides en Région wallonne et à l’étranger ont diminué ces dernières années. Cette évolution se marque de manière plus ou moins importante selon le polluant et se traduit par une amélioration plus ou moins importante de la qualité de l’air. L’impact des émissions acides sur les écosystèmes se mesure au travers du dépassement de seuils critiques au-delà desquels des effets seront constatés. Ceux-ci dépendent des émissions en Région wallonne mais également des émissions d’autres pays voisins qui traversent les frontières.
Les indicateurs présentés dans ce chapitre et se rapportant à l’acidification caractérisent successivement :
- les pressions, c’est-à-dire les «Emissions des substances acidifiantes» (indicateur AirP3),
- l’état ou le niveau des concentrations de ces polluants dans l’air : il s’agit de l’indicateur AirE1 «Qualité de l’air ambiant – acidité»,
- l’impact sur les écosystèmes. Celui-ci est représenté par l’indicateur AirI2 «Dépassement des charges critiques»,
- l’une des réponses apportées afin de réduire les pressions (AirR1 «Accords de branche»).
Si l’ozone est détruit au niveau de la stratosphère, sa concentration au niveau de la troposphère a tendance à augmenter ces dernières années. Cette différence s’explique par le peu d’échange chimique qui existe entre les deux couches. L’évolution de la concentration moyenne d’ozone dans couche la plus basse de l’atmosphère – contribuant à un renforcement de l’effet de serre –, ainsi que les épisodes de pics d’ozones observés en été – avec leurs effets potentiels sur la santé –, résultent d’une chimie complexe faisant intervenir des oxydes d’azote, des composés organiques volatiles mais également l’action du rayonnement ultraviolet. Les émissions de ces substances sont en diminution ces dernières années (voir indicateur AirP4 «Emissions des précurseurs d’ozone»). Toutefois, les niveaux de ces émissions (lors des périodes estivales en particulier) restent préoccupants et induisent des concentrations d’ozone de plus en plus souvent néfastes pour la santé et pour les écosystèmes (voir indicateur AirI1 «Dépassement des seuils de concentration d’ozone troposphérique»).
Certaines substances de nature très différente présentent la caractéristique commune de s’accumuler dans la chaîne des écosystèmes et de présenter une toxicité importante. C’est le cas de substances organiques persistantes regroupant un large éventail de molécules (dont l’une des familles sont les dioxines et les furanes). Ces molécules sont émises par différentes activités humaines. Le danger que représentent ces substances est accentué par le fait qu’elles peuvent être transportées à très grandes distances. Ce danger justifie que des efforts soient menés pour réduire les émissions de ces substances (voir indicateur AirP6 «Emissions annuelles de polluants organiques persistants»).
C’est également le cas des métaux lourds. Leurs émissions sont décrites dans l’indicateur AirP5 «Emissions de métaux lourds» et AirE2 «Qualité de l’air – métaux lourds (plomb)».
Les matières ou particules en suspension, décrites dans les indicateurs AirP7 «Emissions de particules fines (PM10)» et AirE4 «Qualité de l’air ambiant – particules en suspension », sont des particules fines et légères qui peuvent rester longtemps dans l’air et être transportées sur de longues distances. Du fait de leur taille et parfois de leur association avec des éléments toxiques, elles peuvent être nocives pour la santé humaine, en particulier pour le système respiratoire. Une augmentation progressive des concentrations de ces poussières est malheureusement constatée depuis le début du siècle à l’échelle de la planète.
Comment mesurer la qualité de l’air ?
Plusieurs indicateurs présentés dans ce chapitre visent à représenter le niveau de qualité de l’air que nous respirons. Selon le type de polluant (substances acidifiantes, ozone, métaux lourds, PM10), cette mesure de qualité suppose la mesure en continu des concentrations. De telles mesures sont réalisées par différents réseaux. Les caractéristiques de chaque réseau, leur évolution en taille et en techniques utilisées peuvent influencer l’évolution des mesures. Il faut tenir compte de cet élément dans leur analyse.
carte 1-1 Les réseaux de mesures air en région wallonne
Les concentrations sont mesurées dans des stations appartenant à différents réseaux de mesures. Les Réseaux Air se présentent en 1998 de la façon suivante pour les indicateurs retenus :
- réseau télémétrique qui mesure en continu les concentrations en SO2, NO2, MES,
- réseau Soufre-Fumées qui mesure les concentrations en SO2, MES,
- réseau Métaux lourds pour les concentrations en plomb.
Les stations sont classées selon les critères suivants :
- type de station (trafic, industriel ou de fond),
- type de zone (urbain, sub-urbain, rural),
- caractérisation de la zone (résidentielle, commerciale, industrielle, agricole, naturelle ou combinaison de plusieurs types).
En ce qui concerne la qualité de l’air ambiant, les niveaux atteints pour chacun des polluants (c’est-à-dire les concentrations) sont mesurés et comparés aux références disponibles. Ces références découlent de la connaissance scientifique des effets sur la santé (toujours en développement pour certains polluants) et prises en compte sous forme de recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et dans la législation européenne et wallonne sous différentes formes telles que :
- valeurs limites qui doivent être obligatoirement respectées et dont le dépassement implique l’élaboration de plans de réduction visant à diminuer la pollution,
- valeurs guides (ou cibles) qui sont indicatives,
- seuils d’information, seuils de protection de la santé et seuils de protection de la végétation.
Le nombre de stations varie d’année en année, en général le réseau se développe. Le tableau ci-dessous présente la situation pour 1998.
Différents paramètres statistiques sont utilisés pour les mesures tels que :
- la moyenne arithmétique : somme des valeurs mesurées divisée par le nombre de valeurs,
- la médiane (ou P50) : valeur telle que la moitié des mesures lui soit inférieure,
- le centile ou percentile 98 (P98) : valeur telle que 98 % des mesures lui soient inférieures (et par conséquent 2 % les dépassent). Ainsi, dans le cas de valeurs journalières, le percentile 98 est la valeur qui n’est dépassée que durant 7 jours par an.
Ces paramètres statistiques ne sont calculés que si le nombre de données est suffisant, par rapport à la période considérée. (Voir liste des stations de mesures des concentrations en SO2, NO2, PM10 et Pb ci-dessous).
Comment estimer les pressions exercées sur l’atmosphère ?
La connaissance des pressions et de leur évolution implique, pour l’ensemble des polluants, d’estimer leurs émissions. Les émissions rapportées dans ce chapitre reposent pour la plupart sur l’application de la méthode CORINAIR1
développée par l’Agence Européenne de l’Environnement depuis une dizaine d’années. Cette méthode permet d’établir des inventaires des émissions d’un grand nombre de polluants atmosphériques (gaz à effet de serre, substances acidifiantes, précurseurs de l’ozone, métaux lourds, polluants organiques persistants,…) résultant des différentes activités réparties en 11 groupes couvrant le secteur énergétique, l’industrie, le chauffage des logements et des bâtiments tertiaires, les transports, le traitement des déchets, l’agriculture et l’utilisation des sols forestiers.
Ces inventaires sont construits à partir de données relatives d’une part à des activités individualisées (Large Point Source) et d’autre part à des activités diffuses (transports, chauffage, agriculture et certains secteurs industriels notamment).
Dans le premier cas, les émissions sont estimées soit sur base de mesures de débits en cheminée qui sont éventuellement extrapolées sur l’année, soit sur base de données de consommations énergétiques et/ou de volumes de productions industrielles affectées d’un coefficient ou facteur d’émissions issu de la méthode CORINAIR ou d’études plus spécifiques à la situation étudiée.
Dans le second cas, les émissions sont calculées également à partir de facteurs d’émissions appliqués à des données relatives aux consommations énergétiques ou à une variable d’activité spécifique du secteur étudié.
Pour le transport en particulier, les émissions wallonnes sont calculées à l’aide du modèle Myrtille2
basé sur les formules établies dans un modèle européen COPERT. Une version ultérieure de ce dernier est également en cours d’utilisation.
La méthode CORINAIR et son application au fil des années a bien sûr conduit à certaines révisions liées à une meilleure connaissance des phénomènes et à une plus grande maîtrise de l’outil. D’autre part, certains polluants sont encore inventoriés de manière incertaine (les métaux lourds et les POP).
Il résulte de ce qui précède que les données d’émissions doivent être analysées avec suffisamment de précaution.